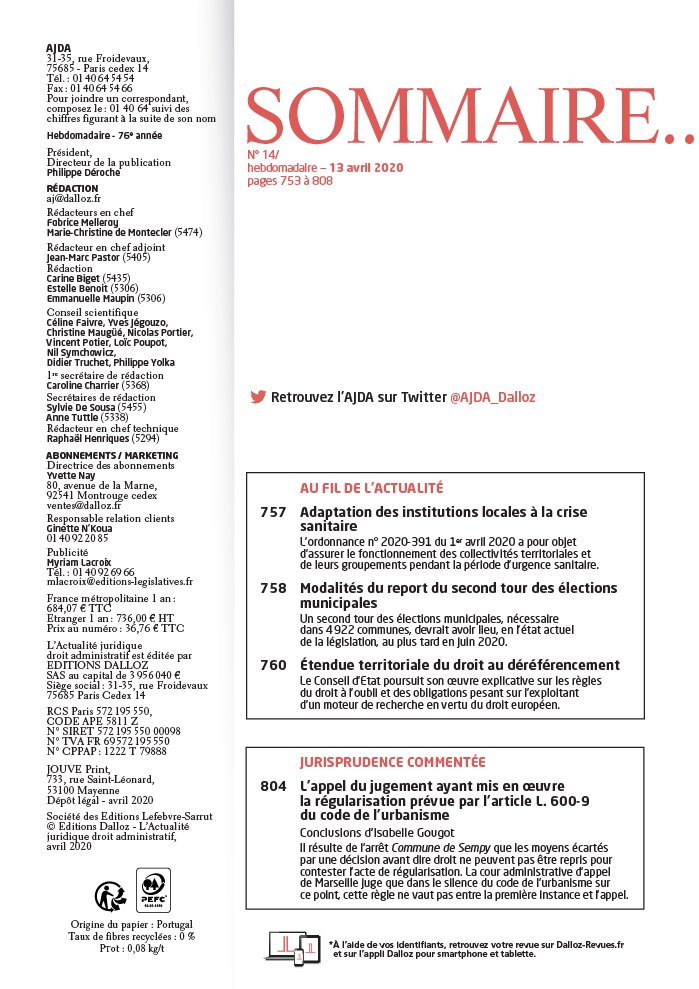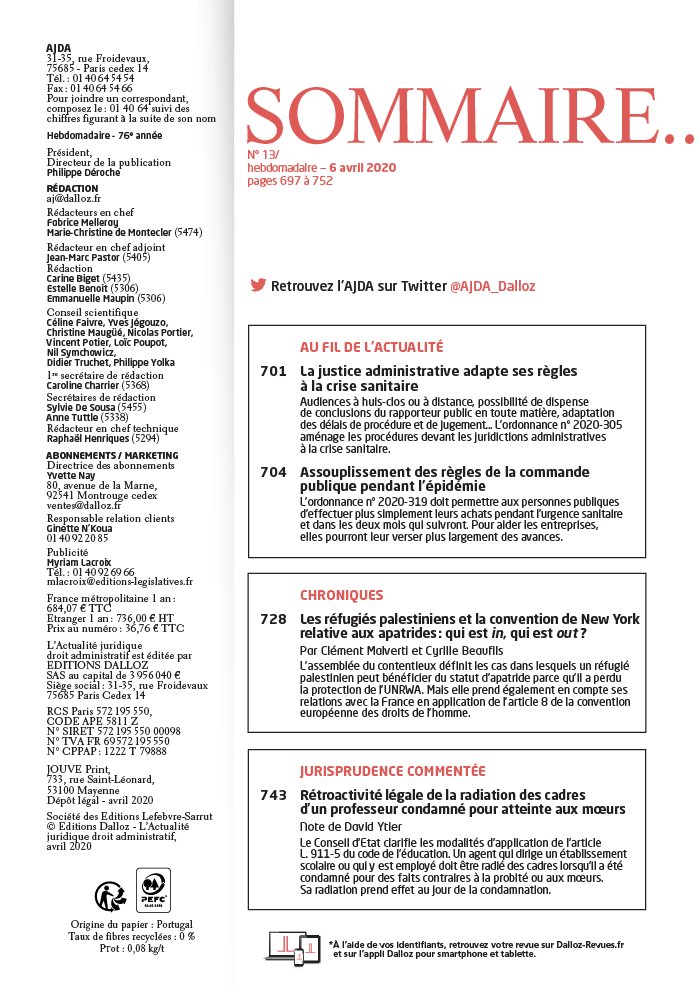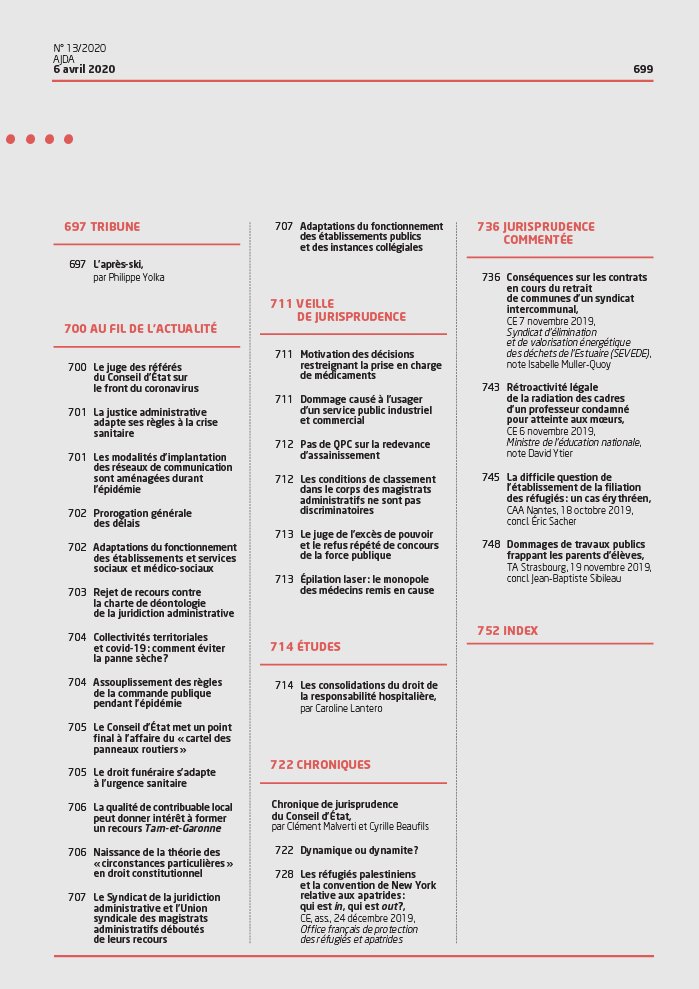CE, ch. réunies, 6 déc. 2019, n° 409212, Lebon T
Article vers lequel renvoie l’un des deux liens restant en litige qui se borne à proposer un résumé du roman du requérant, publié en 2009 et ayant alors fait l’objet d’une couverture médiatique. L’article en cause comporte un certain nombre de données à caractère personnel concernant l’auteur de cet ouvrage autobiographique qui sont toutes extraites de ce livre et dont aucune ne relève de catégories particulières.
Eu égard à la nature et au contenu des données à caractère personnel figurant sur ce site, à leur source ainsi qu’au fait que leur accessibilité procède de l’activité littéraire du requérant et compte tenu de l’intérêt qui s’attache, pour le public, à pouvoir accéder aux recensions de livres publiés à partir d’une recherche portant sur le nom de leur auteur, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pu légalement estimer que l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à ces informations à partir d’une recherche effectuée sur le nom de l’intéressé faisait obstacle, en dépit de leur ancienneté et du fait que l’ouvrage n’est désormais plus édité, à ce qu’il soit fait droit à la demande du requérant.
Site vers lequel renvoie le second des deux liens restant en litige comportant une fiche descriptive du livre écrit par le requérant, faisant état d’un certain nombre de données à caractère personnel le concernant, dont certaines conduisent à révéler son orientation sexuelle. Dès lors que les informations relatives à son orientation sexuelle sont issues du roman à caractère autobiographique qu’il a publié, les données en cause doivent être regardées comme ayant été manifestement rendues publiques par le requérant.
Eu égard à la nature et au contenu des données à caractère personnel figurant sur ce site, au fait que le requérant n’exerce plus d’activités littéraires et que le roman dont elles proviennent n’est aujourd’hui plus édité et compte tenu des répercussions qu’est susceptible d’avoir pour l’intéressé le maintien des liens permettant d’y avoir accès à partir d’une recherche effectuée sur son nom, la CNIL n’a pu légalement estimer, alors même que les informations litigieuses avaient été manifestement rendues publiques par l’intéressé en 2009, que le référencement du lien permettant d’y avoir accès à partir d’une recherche effectuée sur le nom du requérant présentait un intérêt prépondérant pour le public, alors que, par ailleurs, les pages des résultats d’une telle recherche comportaient des liens menant vers des informations faisant état du roman en cause.
Cf., sur la méthode d’appréciation applicable, CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 395335, à publier au Recueil.
Rappr. CE, 6 décembre 2019, Mme X., n°s 403868 403869, à mentionner aux Tables ; CE, 6 décembre 2019, M. X., n° 405910, à mentionner aux Tables.
Rappr. CE, 6 décembre 2019, M. X., n° 393769, à mentionner aux Tables.
Texte intégral
Conseil d’État
N° 409212
ECLI:FR:CEORD:2019:409212.20191206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats
Lecture du vendredi 6 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte aux fins de déréférencement de plusieurs liens obtenus sur la base d’une recherche effectuée à partir de son nom sur le moteur de recherche exploité par la société Google, qui lui a été notifiée par un courrier du 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12) ;
– l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 septembre 2019, GC, AF, BH et ED contre CNIL (C-136/17) ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
— les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Google LLC ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2019, présentée par la CNIL ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé à la société Google de procéder au déréférencement de plusieurs liens vers lesquels renvoyaient des photographies apparaissant dans les résultats affichés par l’onglet « images » du moteur de recherche qu’elle exploite à la suite d’une recherche portant sur son nom. A la suite du refus opposé par la société Google, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte tendant à ce qu’il soit enjoint à cette société de procéder au déréférencement des liens en cause. Par un courrier du 9 mars 2017, la présidente de la CNIL a l’informé de la clôture de sa plainte. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure la société Google de procéder au déréférencement demandé.
Sur l’office du juge de l’excès de pouvoir :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour la CNIL de procéder à une telle mise en demeure afin que disparaissent de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche les liens en cause.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de la CNIL de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. En second lieu, dans l’hypothèse où il apparaît que les liens litigieux ont été déréférencés à la date à laquelle il statue, soit à la seule initiative de l’exploitant du moteur de recherche, soit pour la mise en oeuvre d’une mise en demeure, le juge de l’excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.
Sur le cadre juridique du litige :
5. L’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la présente décision, que : « Le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ».
6. Aux termes de l’article 17 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données : » 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : / a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ; / b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; / c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ; / d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ; / e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ; f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1. […] 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : / a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information […] « .
7. Par son arrêt du 24 septembre 2019 GC, AF, BH et ED contre CNIL (C-136/17), la Cour de justice de l’Union européenne a, en réponse aux questions que lui avait posées le Conseil d’Etat dans sa décision avant-dire-droit du 24 février 2017, précisé qu’elle examinerait ces questions « sous l’angle de la directive 95/46, en tenant, toutefois, également compte du règlement 2016/679 dans son analyse de celles-ci, afin d’assurer que ses réponses seront, en toute hypothèse, utiles pour la juridiction de renvoi ».
En ce qui concerne le « droit au déréférencement » de données à caractère personnel ne relevant pas de catégories particulières :
8. Ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt cité ci-dessus : « Dans le cadre du règlement 2016/679, le législateur de l’Union européenne a prévu, à l’article 17 de ce règlement, une disposition qui régit spécifiquement le » droit à l’effacement « , également dénommé à cet article, » droit à l’oubli « . Dans le même arrêt, la Cour de justice a précisé que : » En application de cet article 17, paragraphe 1, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs énumérés par cette disposition s’applique. Au titre de ces motifs, ladite disposition mentionne le fait que les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement, que la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et qu’il n’existe pas d’autre fondement juridique pour celui-ci, que la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1 ou 2, du règlement 2016/679, qui remplace l’article 14 de la directive 95/46, que les données ont fait l’objet d’un traitement illicite, qu’elles doivent être effacées pour respecter une obligation légale ou qu’elles ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information aux enfants « . Elle a également relevé que : » L’article 17, paragraphe 3, du règlement 2016/679 précise que l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement ne s’applique pas dans la mesure où le traitement en cause est nécessaire pour l’un des motifs énumérés à cette première disposition. Parmi ces motifs, figure, à l’article 17, paragraphe 3, sous a), dudit règlement, l’exercice du droit relatif, notamment, à la liberté d’information « . La Cour a précisé que : » La circonstance que l’article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement 2016/679 prévoit désormais expressément que le droit à l’effacement de la personne concernée est exclu lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit relatif, notamment, à la liberté d’information, garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue une expression du fait que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais doit, ainsi que le souligne le considérant 4 de ce règlement, être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité « . Elle a également précisé que : » Le règlement 2016/679, et notamment son article 17, paragraphe 3, sous a), consacre ainsi explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information, garanti par l’article 11 de la Charte « .
9. Par ailleurs, par son arrêt du 13 mai 2014 Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12), la Cour a dit pour droit que : « Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application de ces dispositions, il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question ».
10. Il découle de ce qui a été dit aux points précédents qu’il appartient en principe à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles ne relevant pas de catégories particulières la concernant, d’y faire droit. Toutefois, il revient à la CNIL d’apprécier, compte tenu du droit à la liberté d’information, s’il existe un intérêt prépondérant du public à avoir accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de cette personne de nature à faire obstacle au droit au déréférencement. Pour procéder ainsi à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information et apprécier s’il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement, il lui incombe de tenir notamment compte, d’une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée et, d’autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d’accéder aux mêmes informations à partir d’une recherche portant sur des mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée ainsi que le rôle qu’a, le cas échéant, joué cette dernière dans la publicité conférée aux données la concernant.
En ce qui concerne le « droit au déréférencement » de données à caractère personnel relevant de catégories particulières :
11. L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la présente décision, que : « I.- Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.- Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi ». Ces dispositions assurent la mise en oeuvre en droit national de celles de l’article 9 du règlement général sur la protection des données, lesquelles ont abrogé et remplacé celles de l’article 8 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995.
12. Aux termes de l’article 9 du règlement général sur la protection des données : » 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits. / 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie : / a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée ; […] / e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ; […] / g) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée […] » .
13. Par l’arrêt déjà cité du 24 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que : « 1) Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction ou les restrictions relatives au traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées par ces dispositions, s’appliquent, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, également à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités en tant que responsable du traitement effectué lors de l’activité de ce moteur, à l’occasion d’une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d’une demande introduite par la personne concernée ». Elle a également dit pour droit que : « 2) Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions. / L’article 8, paragraphe 2, sous e), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que, en application de celui-ci, un tel exploitant peut refuser de faire droit à une demande de déréférencement lorsqu’il constate que les liens en cause mènent vers des contenus comportant des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées à cet article 8, paragraphe 1, mais dont le traitement est couvert par l’exception prévue audit article 8, paragraphe 2, sous e), à condition que ce traitement réponde à l’ensemble des autres conditions de licéité posées par cette directive et à moins que la personne concernée n’ait, en vertu de l’article 14, premier alinéa, sous a), de ladite directive, le droit de s’opposer audit traitement pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière. / Les dispositions de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page web sur laquelle des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l’article 8, paragraphe 1 ou 5, de cette directive sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive et dans le respect des conditions prévues à cette dernière disposition, si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche, consacrée à l’article 11 de cette charte ».
14. Il découle de ce qui a été dit ci-dessus que lorsque des liens mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l’article 8 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, abrogé et remplacé par l’article 9 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s’ensuit qu’il appartient en principe à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des données personnelles relevant de catégories particulières la concernant, de faire droit à cette demande. Il n’en va autrement que s’il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d’information, que l’accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de cette personne est strictement nécessaire à l’information du public. Pour apprécier s’il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement au motif que l’accès à des données à caractère personnel relevant de catégories particulières à partir d’une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l’information du public, il incombe à la CNIL de tenir notamment compte, d’une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée et, d’autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d’accéder aux mêmes informations à partir d’une recherche portant sur des mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée.
15. Dans l’hypothèse particulière où les données litigieuses ont manifestement été rendues publiques par la personne qu’elles concernent, il appartient à la CNIL de procéder ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus afin d’apprécier s’il existe ou non un intérêt prépondérant du public de nature à faire obstacle au droit au déréférencement, une telle circonstance n’empêchant pas l’intéressé de faire valoir, à l’appui de sa demande de déréférencement, des « raisons tenant à sa situation particulière », ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt précité du 24 septembre 2019.
Sur l’objet et la recevabilité de la requête :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les liens renvoyant vers les sites « culturez-vous.over-blog.com » et « wrath.typepad.com » n’apparaissent plus, à la date de la présente décision, dans la liste des résultats affichée par le moteur de recherche exploité par la société Google à la suite d’une recherche portant sur le nom du requérant, vers lesquels renvoyaient deux photographies dont celui-ci avait demandé à la CNIL d’ordonner le déréférencement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… ont, dans cette mesure, perdu leur objet et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a demandé à la CNIL d’ordonner à la société Google de procéder au déréférencement ni du lien vers lequel renvoyait une photographie le représentant tenant une pancarte sur laquelle est inscrite la mention « prix de l’Académie Française » ni de celui vers lequel renvoyait la photographie issue du blog « http://karveelt-in-wonderland.over-blog.com » et dont un aperçu apparait sous l’onglet « images » du moteur de recherche Google à la suite d’une recherche portant sur son nom. Il s’ensuit que la requête de M. A… en tant qu’elle porte sur ces deux liens est irrecevable.
18. En revanche et en dernier lieu, si la CNIL soutient que le litige a perdu son objet en tant qu’il porte sur deux liens renvoyant vers les sites « booknode.com » et « babelio.com » dès lors qu’ils n’apparaissent plus dans les résultats affichés par l’onglet « images » du moteur de recherche exploité par la société Google, il ressort des pièces du dossier que ces liens sont encore accessibles sur l’onglet principal du moteur de recherche à partir d’une recherche portant sur le nom de M. A…. Il s’ensuit que la requête conserve son objet en tant qu’elle porte sur ces deux liens.
Sur la légalité de la décision en tant qu’elle porte sur des liens menant vers des pages web contenant des données ne relevant pas de catégories particulières :
19. Il ressort des pièces du dossier que l’article du site BookNode vers lequel renvoie l’un des deux liens restant en litige se borne à proposer un résumé du roman du requérant intitulé Y, publié en 2009 et ayant alors fait l’objet d’une couverture médiatique. L’article en cause comporte un certain nombre de données à caractère personnel concernant l’auteur de cet ouvrage autobiographique qui sont toutes extraites de ce livre et dont aucune ne relève de catégories particulières.
20. Eu égard à la nature et au contenu des données à caractère personnel figurant sur le site BookNode, à leur source ainsi qu’au fait que leur accessibilité procède de l’activité littéraire de M. A… et compte tenu de l’intérêt qui s’attache, pour le public, à pouvoir accéder aux recensions de livres publiés à partir d’une recherche portant sur le nom de leurs auteurs, la CNIL a pu légalement estimer que l’intérêt prépondérant du public à avoir accès à ces informations à partir d’une recherche effectuée sur le nom de l’intéressé faisait obstacle, en dépit de leur ancienneté et du fait que l’ouvrage n’est désormais plus édité, à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. A….
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur des liens menant vers des pages web contenant des données relevant de catégories particulières :
21. Il ressort des pièces du dossier que le site « Babelio » vers lequel renvoie le second des deux liens restant en litige comporte une fiche descriptive du livre Y, faisant état d’un certain nombre de données à caractère personnel concernant le requérant, dont certaines conduisent à révéler son orientation sexuelle. Dès lors que les informations relatives à son orientation sexuelle sont issues du roman à caractère autobiographique qu’il a publié, les données en cause doivent être regardées comme ayant été manifestement rendues publiques par M. A….
22. Eu égard à la nature et au contenu des données à caractère personnel figurant sur le site « Babelio », au fait que le requérant n’exerce plus d’activités littéraires et que le roman dont elles proviennent n’est aujourd’hui plus édité et compte tenu des répercussions qu’est susceptible d’avoir pour l’intéressé le maintien des liens permettant d’y avoir accès à partir d’une recherche effectuée sur son nom, la CNIL n’a pu légalement estimer, alors même que les informations litigieuses avaient été manifestement rendues publiques par l’intéressé en 2009, que le référencement du lien permettant d’y avoir accès à partir d’une recherche effectuée sur le nom de M. A… présentait un intérêt prépondérant pour le public, alors que, par ailleurs, les pages des résultats d’une telle recherche comportaient des liens menant vers des informations faisant état du roman en cause.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2017 en tant qu’elle porte sur le lien renvoyant vers le site « Babelio ».
D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision de la CNIL en tant qu’elle porte sur les liens renvoyant vers les sites « culturez-vous.over-blog.com » et « wrath.typepad.com ».
Article 2 : La décision de la CNIL du 9 mars 2017 est annulée en tant qu’elle porte sur le lien menant vers le site « Babelio ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A…, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à la société Google.