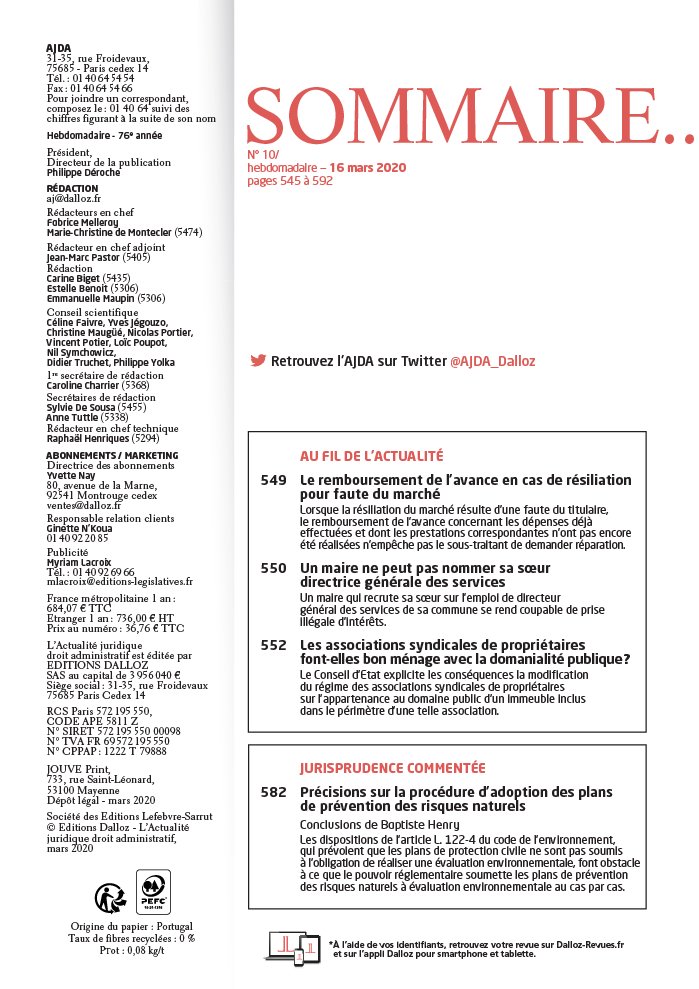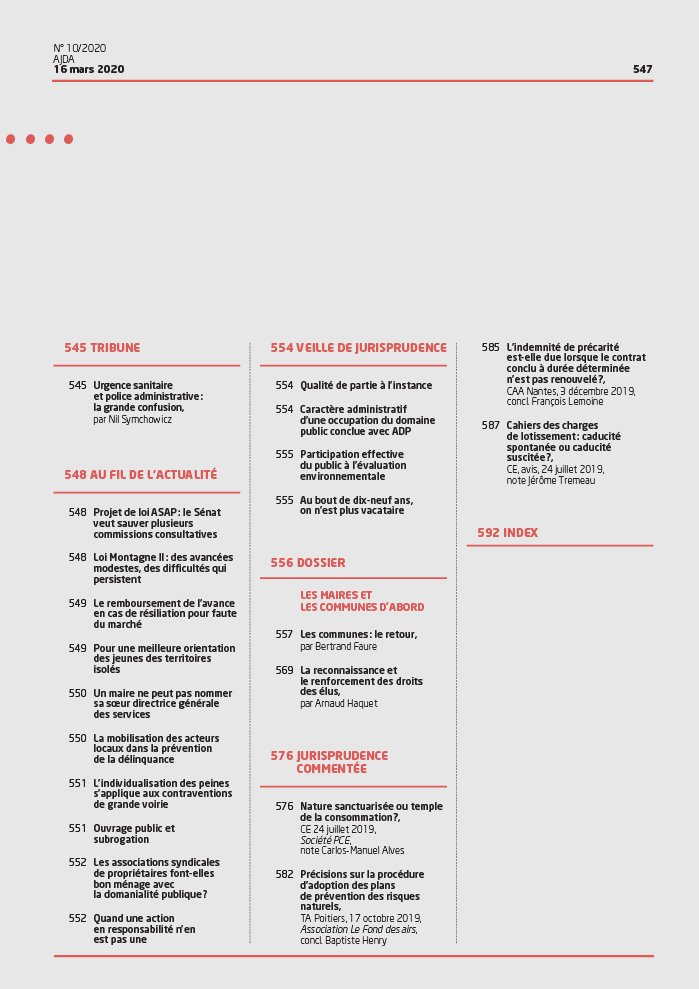CE, 9-10 chr, Société Pharmacie centrale de la gare 13 mars 2020, n° 421725, Lebon T.
Rappr., dans le cas de la suppression d’une partie des données soumises au contrôle, CE, 24 juin 2015, SELAS Pharmacie Réveillon, n° 367288, p. 224 ; dans le cas de la rétention de données, CE, 23 décembre 2011, Société SD2R, n° 322463, inédite au Rec.
Texte intégral
Conseil d’État
N° 421725
ECLI:FR:CECHR:2020:421725.20200313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9e – 10e chambres réunies
M. Aurélien Caron, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP L. POULET-ODENT, avocats
Lecture du vendredi 13 mars 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie centrale de la gare a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1407440 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15VE02592 du 26 avril 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Pharmacie centrale de la gare contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 13 septembre 2018 et le 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharmacie centrale de la gare demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, Auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Pharmacie centrale de la gare ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pharmacie centrale de la gare qui exploite une officine de pharmacie à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 15 mars 2011, suivi de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos de 2008 à 2010 en matière d’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir mis en oeuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal et rejeté la comptabilité de la société comme non probante, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci. Par un jugement du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Pharmacie centrale de la gare tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de ces contrôles ainsi que la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 avril 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
2. Aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : » II.- En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (…) « . Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui décide d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d’option jusqu’à l’expiration du délai qui lui a été fixé par l’administration pour réaliser ces traitements.
3. Aux termes de l’article L. 74 du même livre dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l’article L. 47 A ». Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en oeuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite du contrôle inopiné effectué le 15 mars 2011, l’administration fiscale a informé la société Pharmacie centrale de la gare de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée. La société a décidé d’effectuer elle-même ces traitements informatiques conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 ci-dessus. Par courriers du 8 avril 2011 s’agissant des exercices clos en 2008 et 2009, et du 29 septembre 2011 s’agissant de l’exercice clos en 2010, l’administration a transmis à la société les cahiers des charges détaillant les traitements à effectuer avant respectivement les 29 avril et 20 octobre 2011. La société a transmis le 30 mai 2011 s’agissant de la première période vérifiée, et le 13 février 2012 s’agissant de la seconde période vérifiée, une partie des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements. Après avoir accordé à la société des délais supplémentaires, l’administration lui a notifié, par courriers du 7 octobre 2011 s’agissant de la première période vérifiée et du 1er juin 2012 s’agissant de la seconde, deux procès-verbaux constatant le défaut de réalisation d’une partie des traitements informatiques demandés et précisant que cette carence était susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. En l’absence de réalisation des traitements manquants, cette procédure a été effectivement mise en oeuvre par l’administration fiscale.
5. Pour retenir la qualification d’opposition à contrôle fiscal justifiant la mise en oeuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel de Versailles a notamment relevé que l’administration fiscale avait accordé à la société Pharmacie centrale de la gare des délais suffisants pour effectuer les traitements informatiques que celle-ci avait choisis de réaliser elle-même et qu’il lui avait été possible de renoncer à cette option si elle avait estimé ne pas être en mesure, techniquement, de satisfaire aux exigences des cahiers des charges qui lui avaient été transmis. En jugeant que le comportement de la société caractérisait une opposition à contrôle fiscal sans rechercher, d’une part, si elle avait été informée de la possibilité qui lui était ouverte de renoncer à l’option prévue au b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et de choisir l’une ou l’autre des deux autres options prévues par ces mêmes dispositions, et d’autre part, si les traitements informatiques non réalisés par la société étaient nécessaires au contrôle de sa comptabilité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société Pharmacie centrale de la gare est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Pharmacie centrale de la gare au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 26 avril 2018 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à la société Pharmacie centrale de la gare la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie centrale de la gare et au ministre de l’action et des comptes publics.